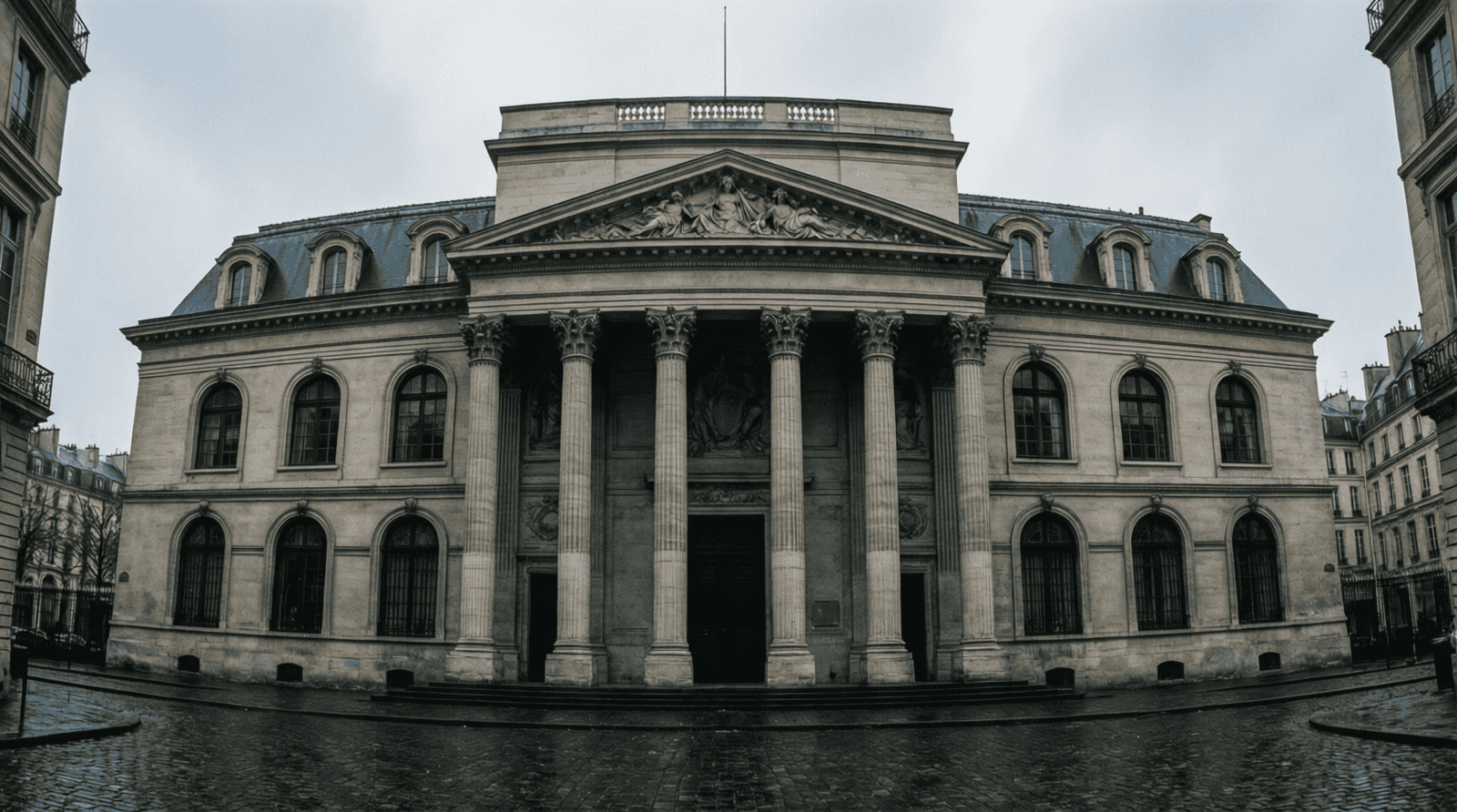Il était juif dans une Angleterre anglicane, romancier dans un monde de propriétaires terriens, dandy flamboyant parmi les gentlemen austères. Benjamin Disraeli n’avait aucune des qualifications que la politique victorienne exigeait, et c’est précisément pour cela qu’il a transformé le conservatisme britannique en force politique moderne. Là où ses contemporains héritaient du pouvoir, il l’a conquis. Là où ils géraient le statu quo, il a réformé. Son parcours, du fils endetté d’un homme de lettres au sommet du « greasy pole », reste la démonstration la plus convaincante que le conservatisme fonctionne quand il repose sur le mérite individuel plutôt que sur le privilège hérité.
Parcours
Naissance à Bloomsbury, Londres, dans une famille juive d’origine italienne. Son père Isaac D’Israeli est un homme de lettres respecté mais sans fortune politique.
Baptisé anglican à 12 ans, après une dispute entre son père et la synagogue de Bevis Marks. Sans cette conversion, il n’aurait jamais pu siéger au Parlement, les juifs en sont exclus jusqu’en 1858.
Publication de Vivian Grey, roman satirique écrit à 21 ans. Succès initial, mais quand on découvre que l’auteur est un « parvenu juif » sans connections sociales, la réputation du jeune Disraeli est sévèrement attaquée.
Élu député conservateur à Maidstone après quatre défaites électorales. Son premier discours est un désastre, huées et rires, mais il conclut par une phrase devenue légendaire : « Le moment viendra où vous m’écouterez. »
Publication de Sybil, or The Two Nations, roman qui forge le concept de « One Nation », l’Angleterre divisée en deux peuples, les riches et les pauvres, « entre lesquels il n’y a ni rapport ni sympathie ». Acte fondateur du conservatisme social.
Attaque dévastatrice contre Robert Peel lors de l’abrogation des Corn Laws. Disraeli fracture le parti Tory, mais s’impose comme le débatteur le plus redouté de Westminster.
Comme Chancelier de l’Échiquier, fait passer le Reform Act qui double l’électorat britannique, d’un à deux millions de votants, en accordant le suffrage aux ouvriers urbains. Un conservateur élargit le droit de vote plus que les libéraux ne l’avaient jamais osé.
Coup de maître géopolitique : rachat des parts égyptiennes du Canal de Suez pour 4 millions de livres, financées en urgence par les Rothschild, avant même l’approbation du Parlement. La Grande-Bretagne prend le contrôle de la route des Indes.
Congrès de Berlin : Disraeli, 73 ans et malade, réduit les gains russes dans les Balkans, acquiert Chypre pour la Couronne et rentre à Londres en proclamant « la paix dans l’honneur ». Apogée de sa carrière diplomatique.
Mort à Londres, un an après sa défaite électorale face à Gladstone. La reine Victoria, qui le considérait comme un ami intime, envoie des fleurs de primevères, sa fleur préférée, sur sa tombe.
Réformer pour préserver : la méthode Disraeli
Le conservatisme de Disraeli ne se comprend qu’en opposition à deux adversaires qu’il méprisait également : le libéralisme utilitariste des Whigs et l’immobilisme stupide des Tories réactionnaires. Sa thèse, développée dans la trilogie romanesque Coningsby–Sybil–Tancred (1844-1847), tenait en une idée simple : une nation qui abandonne ses classes populaires à la misère creuse sa propre tombe.
Ce n’était pas de la compassion, c’était du calcul politique. Disraeli avait compris que le chartisme et les révoltes ouvrières menaçaient l’ordre constitutionnel bien plus que n’importe quelle réforme sociale. Son programme de 1874-1880 en découle directement : décriminalisation des syndicats (1875), loi sur la santé publique, loi sur les logements insalubres, Factory Act limitant la semaine de travail à 56 heures. Des réformes permissives, jamais contraignantes, l’État ouvre des possibilités, les collectivités locales décident. C’est l’exact inverse du dirigisme bureaucratique.
« Le parti conservateur est un parti national, ou il n’est rien. »
Benjamin Disraeli, discours de Crystal Palace, 1872
Le Reform Act de 1867 illustre cette méthode avec une clarté presque brutale. En doublant l’électorat et en accordant le vote aux ouvriers des villes, Disraeli a fait quelque chose que les libéraux de Gladstone n’osaient pas : parier que les classes populaires voteraient conservateur si on leur donnait des raisons concrètes de le faire. Pas de grands discours moraux, pas de promesses abstraites, des lois, des logements, des conditions de travail. Le résultat lui donna raison en 1874, avec une majorité écrasante.
La rivalité avec Gladstone cristallise deux visions irréconciliables du pouvoir. Gladstone, Eton, Oxford, fils de planteur esclavagiste repenti, incarnait le moralisme libéral : tout réduire à une question de conscience. Disraeli, autodidacte, endetté, outsider, incarnait le pragmatisme conservateur : juger les politiques à leurs résultats, pas à leurs intentions. La reine Victoria résuma la différence avec une franchise royale : Gladstone « me parle comme si j’étais une réunion publique », tandis que Disraeli « me parle comme si j’étais une femme ». Au-delà de l’anecdote, c’est une leçon sur l’exercice du pouvoir : convaincre vaut mieux que sermonner.
Sur la politique étrangère, Disraeli a forgé l’impérialisme conservateur moderne, non pas comme aventure coloniale, mais comme défense des intérêts stratégiques britanniques. Le rachat du Canal de Suez, réalisé en quelques jours sans vote parlementaire, reste un modèle d’audace exécutive. Le Congrès de Berlin, où il a tenu tête à Bismarck et contenu l’expansionnisme russe, a démontré que la diplomatie conservatrice repose sur la force et la négociation, jamais sur les bons sentiments.
Il y avait aussi chez Disraeli une fierté civilisationnelle assumée qui résonne aujourd’hui. Son roman Tancred (1847) exalte les racines juives du christianisme et imagine un retour en Terre sainte, une vision proto-sioniste que Theodor Herzl reconnaîtra comme une influence sur le mouvement naissant. Disraeli se décrivait comme « la page blanche entre l’Ancien et le Nouveau Testament » et considérait les juifs comme « la race aristocratique du monde ». Il refusait de choisir entre ses origines juives et son identité britannique, il revendiquait les deux comme indissociables, inscrites dans une même civilisation judéo-chrétienne dont il n’avait pas à s’excuser.
Les contradictions de Disraeli sont réelles. Son opportunisme était légendaire, il a changé de positions plus souvent que de gilet. Ses théories raciales sur la « supériorité juive », bien qu’exprimant une fierté de persécuté, ont été récupérées par les antisémites du XXe siècle selon une ironie cruelle. Et ses réformes sociales, souvent portées par ses ministres plutôt que par lui-même, relevaient davantage du pragmatisme que de la conviction profonde.
Mais c’est justement cette capacité à adapter les moyens sans trahir les fins qui fait de lui un modèle. Disraeli n’a pas inventé le conservatisme, il l’a rendu opérationnel. Il a prouvé qu’on pouvait réformer le suffrage sans révolution, améliorer les conditions ouvrières sans socialisme, projeter la puissance sans imprudence. Le conservatisme comme méthode plutôt que comme idéologie figée.
À retenir
- Le mérite contre le privilège. Disraeli a démontré que le conservatisme n’a pas besoin d’être un club de naissance. Outsider juif dans une Angleterre protestante, autodidacte parmi les diplômés d’Oxford, endetté parmi les héritiers, il a gravi le « greasy pole » par le talent rhétorique, l’audace politique et une capacité de travail acharnée. Son parcours reste l’argument le plus puissant contre ceux qui réduisent le conservatisme à la défense des intérêts acquis.
- Réformer pour conserver. Le « One Nation conservatism » de Disraeli repose sur une intuition fondamentale : une société qui ignore ses fractures sociales ne les résout pas, elle les radicalise. En doublant l’électorat, en légalisant les syndicats, en légiférant sur les logements et la santé publique, il a coupé l’herbe sous le pied des socialistes et des révolutionnaires. La réforme concrète comme antidote à la révolution, c’est la leçon que les conservateurs contemporains oublient chaque fois qu’ils préfèrent moraliser plutôt qu’agir.
- La fierté civilisationnelle comme force politique. Disraeli n’a jamais renié ses origines, jamais minimisé l’héritage judéo-chrétien, jamais présenté d’excuses pour la puissance britannique. Cette fierté assumée, de Suez à Berlin, de Tancred au titre d’Impératrice des Indes, n’était pas de l’arrogance : c’était la condition de l’action. Un pouvoir qui doute de sa légitimité est un pouvoir qui n’agit plus. La question reste ouverte : les conservateurs d’aujourd’hui ont-ils encore cette conviction, ou se contentent-ils de gérer le déclin en s’excusant d’exister ?
Photo : Cornelius Jabez Hughes / Wikimedia Commons, domaine public